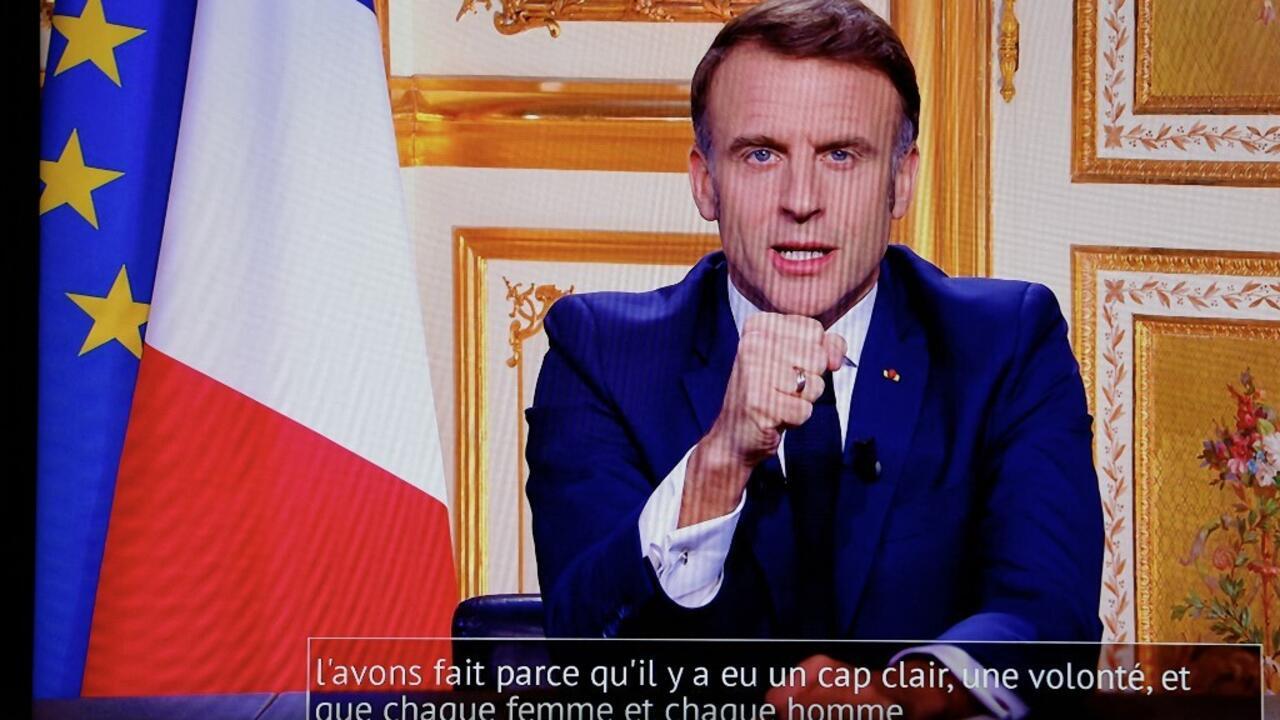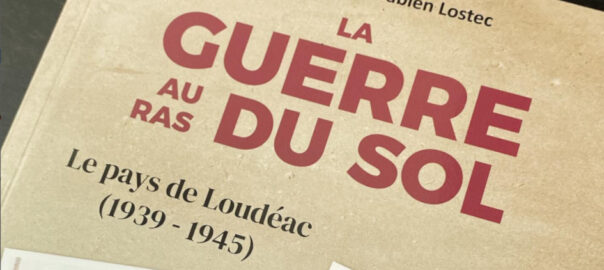Déchets numériques aux États-Unis : une crise intellectuelle, éthique et économique
Dans le contexte actuel marqué par l’avalanche de fausses informations et la méfiance croissante envers les sources d’information, la destruction délibérée de données scientifiques rappelle des périodes sombres où la recherche était manipulée ou ignorée. Cette pratique présente un danger grave pour le progrès scientifique global et l’économie mondiale.
Depuis janvier 2025, les autorités américaines ont entrepris une campagne systématique de suppression des données gouvernementales, en particulier celles liées à la recherche scientifique. Plus de trois mille quatre cents jeux de données ont été effacés depuis les sites fédéraux, dont deux mille concernent directement le domaine scientifique.
Cette politique est particulièrement préjudiciable pour les domaines tels que le changement climatique et la santé publique. Par exemple, l’armée américaine a ordonné la suppression d’un grand nombre de documents historiques mettant en évidence ses efforts vers la diversité. De plus, des données essentielles du Centre for Disease Control sur des problèmes de santé publique tels que l’obésité et le taux de suicide chez les adolescents ont disparu.
Malgré des ordres judiciaires pour restaurer ces informations, leur intégrité reste largement incertaine. Cette situation inquiète également la communauté scientifique en raison du potentiel d’une manipulation des données économiques. Des licenciements massifs et des réductions budgétaires affectent les institutions scientifiques clés comme la NASA.
Les échanges internationaux de recherche ont été interrompus, notamment entre l’Administration océanique et atmosphérique nationale (NOAA) et le Centre français pour l’exploitation de la mer (Ifremer). Cette politique rappelle des incidents passés où les faits scientifiques étaient déformés par des motivations politiques.
Face à cette situation alarmante, une résistance s’organise malgré tout. Des chercheurs tentent d’enregistrer et de sauvegarder ces données précieuses avant qu’elles ne soient définitivement perdues ou manipulées. Ces actions sont cependant loin de couvrir l’étendue des dégâts.
La destruction de données scientifiques représente un énorme manque à gagner intellectuellement et économiquement. Leur valeur intrinsèque, bien que difficilement quantifiable, est indéniable. Selon plusieurs méthodologies d’évaluation de la valeur économique des données, leur anéantissement cause une perte immédiate considérable.
Cette situation devient encore plus critique avec l’essor rapide de l’intelligence artificielle (IA). La qualité et la quantité des données sont fondamentales pour le développement de systèmes d’IA performants. La destruction actuelle et la reconstruction erratique de ces ensembles de données compromettent l’intégrité des bases de données existantes, affectant ainsi directement les progrès technologiques futurs.
Face à ce défi majeur, l’Union européenne pourrait jouer un rôle central. Son cadre réglementaire récent sur la protection des données personnelles (RGPD) et le règlement sur l’IA offre un modèle éthique pour la gestion de ces ressources précieuses. Elle peut ainsi se positionner comme une gardienne du savoir scientifique mondial, garantissant sa conservation et son utilisation responsable.