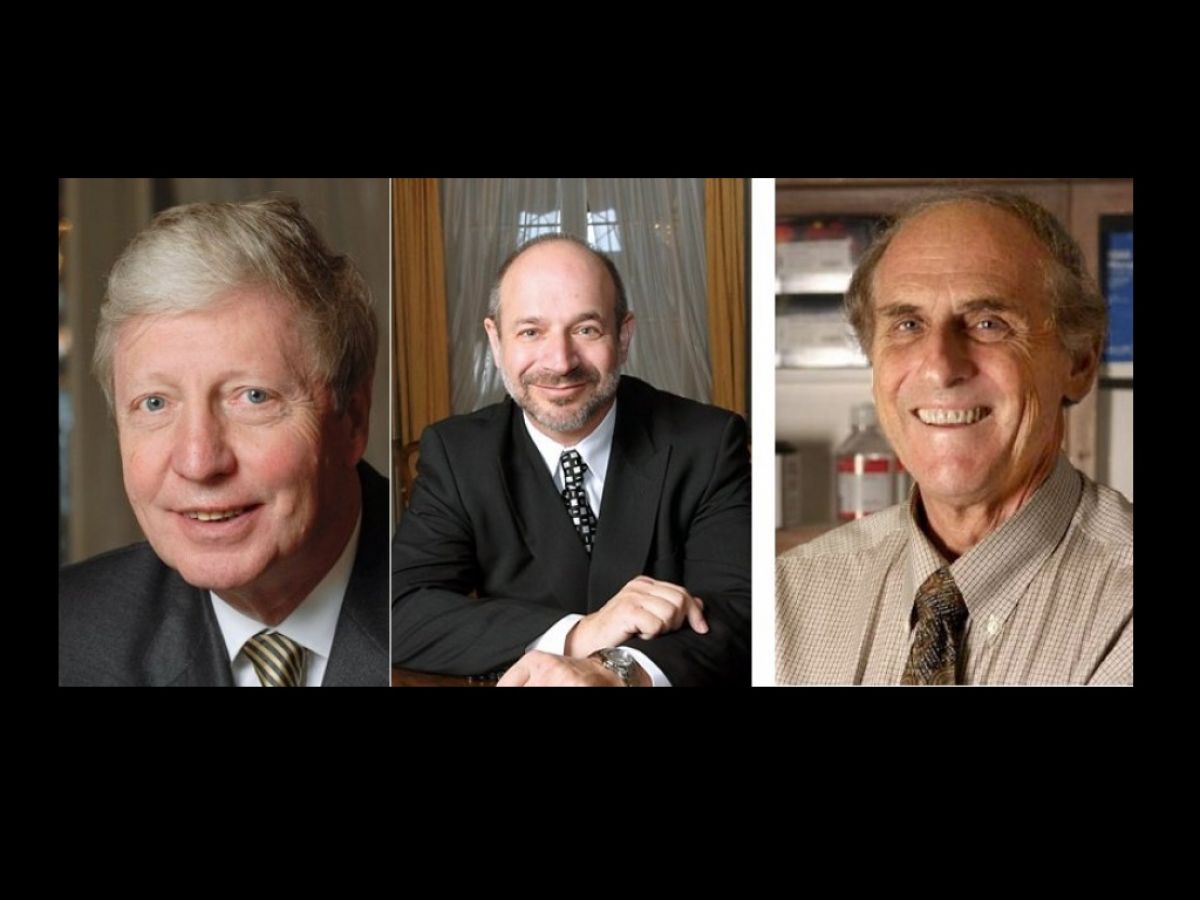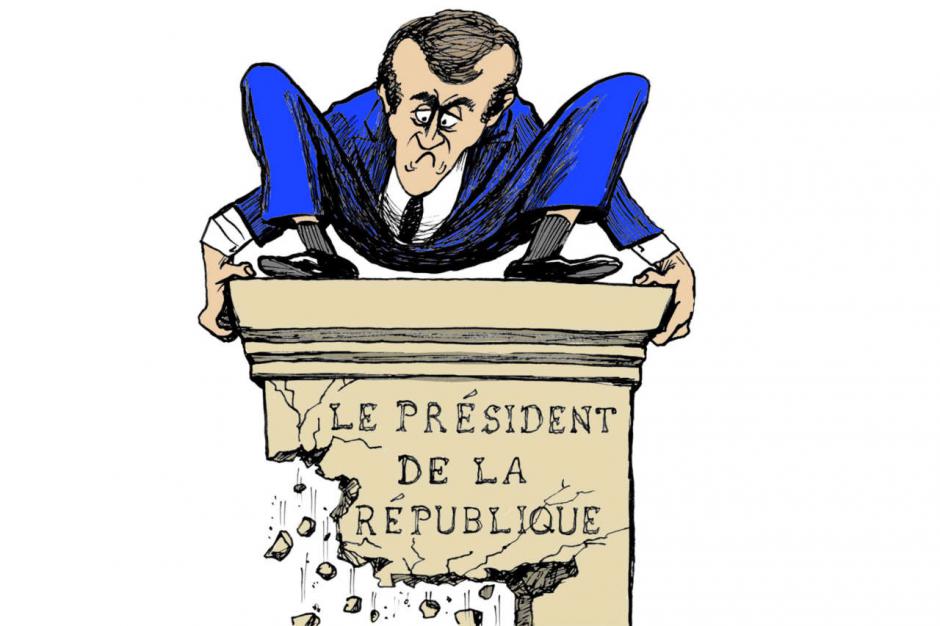L’armée israélienne traverse une situation critique à l’aube de sa troisième année de conflit au Gaza. Des dizaines de milliers de réservistes ont rejeté la conscription, mettant en danger l’efficacité de Tsahal, qui dépend largement de ces forces pour compenser son effectif restreint. À l’origine, les appels à l’armée avaient connu une mobilisation massive : 360 000 réservistes ont été appelés dès octobre 2023, mais la dynamique s’est effondrée. En mars 2025, seuls 60 % des convocations ont été respectées, contre plus de 100 % au début du conflit. Certains régiments ne comptent même pas 50 % de participants. Plus de 100 000 réservistes auraient cessé leur engagement.
Le mouvement s’accompagne d’une révolte symbolique : des centaines de lettres ouvertes, publiées dans la presse israélienne, exigent l’arrêt immédiat du conflit et une priorité donnée aux négociations pour libérer les otages détenus par le Hamas. Ce refus de servir, autrefois marginal, devient un phénomène de masse, rompant avec la tradition israélienne d’une armée perçue comme l’expression du « peuple en armes ».
Les raisons de ce rejet sont multiples : fatigue, désaccords stratégiques et mécontentement politique. Le gouvernement Netanyahu dénonce cette situation comme une « action impardonnable » qui affaiblit Israël face au Hamas. Cependant, l’armée évite toute répression massive pour ne pas transformer les réservistes en martyrs. Pour pallier la crise, Tsahal envisage d’élargir l’âge de service et d’affecter davantage de conscrits aux zones de combat. Ces mesures restent insuffisantes face à la démotivation croissante.
Ce désengagement révèle une fracture nationale profonde : des manifestations massives à Tel-Aviv rassemblent des milliers de citoyens exigeant la fin de la guerre et la démission du Premier ministre Benjamin Netanyahou. L’émigration connaît également un pic inquiétant, avec 500 000 Israéliens partis en 2024 et 40 % envisageant de quitter le pays.
Si l’échec des réservistes reste mineur par rapport à leur nombre total, son impact symbolique est majeur : il ébranle la légitimité de Tsahal comme « armée populaire », remet en question l’unité nationale et alimente le débat sur la moralité du conflit. Israël révèle ainsi une société traversée par le doute, où les citoyens se demandent s’il faut continuer une guerre perçue comme un échec sans précédent au prix d’une usure militaire et morale.
Tsahal s’apprête à lancer l’offensive « Chars de Gédéon II », mobilisant 130 000 réservistes, mais la crise interne menace désormais sa capacité à mener une guerre durable.